 | | |
| |
JEF
Février 2022
Je n’ai jamais été dans le coup de l'époque ! [1]
Une
fois n’est pas coutume, je vous emmène aujourd’hui dans le quotidien des
éditions Jacques Brel. En
1962, à la demande de Jacques, ma mère devient
son éditrice. Elle crée la société
d’édition musicale « Arlequin ». En octobre de la même année, elle signe son premier contrat
d’édition avec son unique artiste pour gérer, au Benelux, quatre titres dont « Le
Plat Pays ». Du
haut de mes 9 ans, je la revois encore derrière
sa machine à écrire, ajustant feuilles
de carbones et papiers pelures pour ses courriers, installée dans son petit bureau organisé au premier
étage de la maison familiale à Schaerbeek. Patiemment,
souvent avec étonnement, ma mère, que chacun surnomme Miche, s’initie au monde
complexe de l’édition, en découvre les joies, les labyrinthes et aléas. Au fil
des années, mon père lui confie tous ses nouveaux titres. La directrice voit alors progressivement
s’étendre ses territoires vers des contrées éloignées et s’élargir le catalogue des
éditions Arlequin, devenues les éditions Pouchenel. Depuis
1981, travaillant à ses côtés, je prends conscience de la complexité de ce métier.
En
2006, ma mère me transmet le flambeau de la gestion de sa maison d’édition que
je rebaptise les Éditions Jacques Brel. Le cadeau est exceptionnel ! Le
temps continue à couler inexorablement. Miche s’est envolée. Le nombre des années, comme c’est le cas pour
chacun, s’accumule régulièrement au compteur de ma vie et je reste consciente
que ma responsabilité consiste aussi à envisager l’avenir. Depuis
2004, les équipes de la Société Warner Chappell coéditent avec nous 16 titres de Jacques dont « Ne me quitte pas ». En
ce début 2022, Warner reçoit
un mandat supplémentaire, celui de gérer également l’édition et la sous-édition
des quelques 130 chansons
des Éditions Jacques Brel. 60
ans après sa création, la maison d’édition du petit bureau de la maison
familiale élargit donc encore sa mission de diffusion de l’œuvre de mon père
grâce à cette collaboration avec le réseau international de la société Warner. Cette
décision rejoint entièrement mes objectifs
de transmission comme le furent à
l’époque, ma première conférence, ma première exposition, notre promenade dans
Bruxelles avec Brel, la réalisation de films ou la publication de la Chronique
de la vie de mon père, dont je vous reparlerai bientôt à l’occasion de la
parution, en juin prochain, du premier volume intitulé « Jacky ». Le
développement de ce partenariat avec la
société Warner se situe donc à l’opposé
de tout ce qui se fait actuellement par la vente de catalogues d’artistes. Cette
nouvelle collaboration s’inscrit au contraire dans un esprit de continuité et de développement de notre travail quotidien aux Éditons Jacques
Brel. Et
il me semble à nouveau avancer à contre-courant tout comme lors de la création
de la Fondation, quand ils étaient nombreux
à penser qu’archiver des vieux papiers concernant mon père ne mènerait
pas bien loin. Décidément
et sans l’ombre d’un regret je peux adhérer à cette phrase de Jacques : « Je n’ai jamais été
dans le coup de l'époque ! » Pourquoi pas. France Brel
| | | |
| | 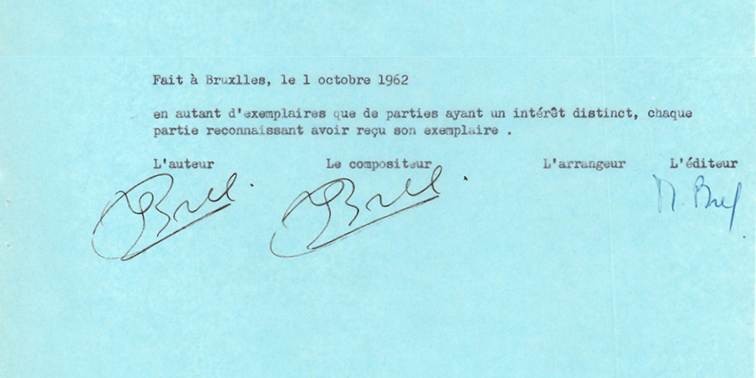 | | | |
| | Signatures du premier contrat de Jacques Brel aux éditions Pouchenel, le 1er octobre 1962. | |
| |
LES EDITIONS JACQUES BREL signent un contrat de gestion éditoriale et sous-édition avec WARNER CHAPPELL MUSIC FRANCE pour le monde, hors Belgique. Warner Chappell Music France annonce la signature d’un
contrat de gestion éditoriale et de sous-édition pour le monde hors Belgique
sur toutes les œuvres écrites et/ou composées par Jacques BREL qui sont éditées
ou coéditées par Les Editions Jacques Brel, ce qui constitue la grande majorité
des œuvres du Grand Jacques.
Warner Chappell Music France co-éditait jusqu’à présent
(avec Les Editions Jacques Brel) 16 œuvres du répertoire de Jacques Brel, parmi
lesquelles « NE ME QUITTE PAS » (et sa version anglaise « IF YOU GO AWAY »), «
LE MORIBOND » (et sa version anglaise « SEASONS IN THE SUN»), « LA VALSE A
MILLE TEMPS », « MARIEKE », « L’IVROGNE », etc. A celles-ci s’ajoutent désormais plus d’une centaines
d’oeuvres dont Les Editions Jacques Brel resteront éditeur ou co-éditeur et que
les bureaux de Warner Chappell dans le monde vont désormais administrer pour ce
qui revient aux Editions Jacques Brel. Retrouvez ci-dessous une sélection de célèbres titres de
Jacques Brel ainsi que certaines reprises emblématiques par des artistes
français et internationaux. | | | |
| |
Matthieu Tessier
Président de Warner Chappell Music France :« Les équipes de Warner Chappell travaillent jour après
jour, main dans la main avec France Brel, au rayonnement de ces œuvres, en
proposant des exploitations qui respectent strictement l’esprit de l’œuvre de
l’Auteur. France Brel nous fait aujourd’hui l’honneur de signer un
contrat de gestion éditoriale et de sous-édition avec Warner Chappell Music
France, pour le monde hors Belgique, qui prévoit d’étendre ce travail à toutes
les œuvres écrites et/ou composées par Jacques BREL qui sont éditées ou coéditées
par les Editions Jacques Brel, ce qui constitue la grande majorité de son
répertoire.
C’est l’un des catalogues les plus prestigieux de la chanson
française que Warner Chappell va désormais avoir la chance de représenter
mondialement, c’est une grande fierté pour nos équipes, et pour moi-même en
tant que Président de Warner Chappell Music France. Je remercie France Brel pour sa confiance, et lui assure que
les équipes de Warner Chappel Music feront leur maximum pour continuer d’œuvrer
au quotidien afin de mettre en lumière mondialement ce sublime répertoire
élargi qui est désormais entre nos mains. »
France Brel :
Directrice des Editions Jacques Brel « Signer un mandat de représentation avec la société Warner
Chappell est la suite d’une histoire qui commence en 1962. Cette année-là, ma
mère, à la demande de son mari, Jacques Brel, crée les Editions musicales
Pouchenel à Bruxelles. Au fil des années qui confirment le succès des chansons de
mon père, les sollicitations pour leur utilisation ne cessent d’augmenter et Ne
me quitte pas commence à voyager autour du monde. Depuis 1981, travaillant aux
côtés de ma mère, je prends conscience de la complexité de l’Edition
musicale et je fais la connaissance de nos partenaires dont Warner Chappell
Music. Le 18 mars 2004 nous
collaborons plus étroitement encore avec leurs équipes grâce à un accord de
coédition. En 2006, ma mère me transmet le flambeau de la gestion des
Editions Pouchenel qui deviennent Les Editions Jacques Brel. Le cadeau est exceptionnel ! Les chansons de mon père
sont interprétées un peu partout autour de la Terre depuis de nombreuses
années. Défendre son œuvre, réfléchir à sa diffusion dans le monde complexe de
l’Edition, nécessitent un réseau à l’échelle internationale. Au moment où je vois augmenter les années au compteur de ma
vie, je suis très heureuse de confier aux équipes de Warner un mandat pour
représenter dans le monde, sauf en Belgique, la gestion des titres des Editions
Brel, nées il y a 60 ans. Derrière ce mandat de représentation je souhaite que les
chansons de Jacques Brel, grâce à la puissance de leurs émotions universelles
puissent au-delà des frontières, aujourd’hui comme hier, offrir aux artistes et
au public, telles des perles de pluies venues de pays où il ne pleut pas, des
traits d’union de sensibilité, des frissons d’humanité. » | | | |
| |  | | | |
|
|
|
| |  | | | |
| | Voici un extrait du récit pour l’année 1945
En juin 1946, Jacky termine sa quatrième année d’études à la neuvième place sur 28 élèves.
Durant toute l’année, il est resté le premier en élocution. La direction de l’institut
lui demande cependant, avant d’être autorisé à passer dans l’année supérieure,
de présenter à la rentrée un travail d’algèbre. Fidèle en amitié, Jacky profite de ce début
de congé scolaire pour rencontrer plus longuement ses camarades qui terminent
des classes supérieures à la sienne. Les amis, heureux d’être libérés de leur
obligation scolaire, partagent mille sujets de conversation et commentent leurs
intérêts du moment. Jacky montre ses progrès musicaux en grattant quelques
morceaux sur sa nouvelle guitare. Bavardant avec Robert Martin, celui-ci lui
parle de sa nouvelle passion pour la poésie et en particulier pour les poèmes
de Charles Baudelaire, découverts il y a peu et qui, selon lui, décrit si bien
cette profonde mélancolie, le spleen. Il lui cite ce vers :
Quand le ciel bas et lourd comme
un couvercle
Sur l’esprit gémissant en proie
aux longs ennuis…[1] Et mon père
tout à coup se sent moins seul face au gouffre de l’ennui qui colore ses jours
et au mal-être de ce ciel bas qui l’étouffe parfois.
Le 13 juillet 1946,
lors de la proclamation des résultats, Jacky récompensé
pour ses compositions françaises, reçoit un exemplaire du célèbre ouvrage de
Cervantès, Don Quichotte. Dès la fin
de la séance de remise de prix, non sans
impatience, le lauréat ouvre le livre au hasard et lit quelques lignes qui
étrangement évoquent aussi un départ discret.
Ainsi, sans mettre âme qui vive
dans la confidence de son intention, et sans que personne le vît, un beau
matin, avant le jour, qui était un des plus brûlants du mois de juillet, il
s’arma de toutes pièces, monta sur Rossinante, coiffa son espèce de salade,
embrassa son écu, saisit sa lance, et, par la fausse porte d’une basse-cour,
sortit dans la campagne, ne se sentant pas d’aise de voir avec quelle facilité
il avait donné carrière à son noble désir[2]. Ce que nous pensions, ce que nous
rêvions[3]
Ce passage, évoquant un désir d’évasion par la porte d’une basse-cour,
amuse Jacky et l’incite à poursuivre l’ouvrage. Il le glisse dans le sac à dos
qu’il prépare pour sa prochaine randonnée. Dans l’une de ses dernières lettres
à Suzanne qui va bientôt partir en vacances avec ses parents, Jacky est heureux
de lui annoncer qu’il a réussi à regrouper quatre copains du quartier, dont
Robert et Raymond, autour de son projet de camp dans les Ardennes. Parfois dans
ses courriers, l’amoureux se risque à glisser quelques vers, inspirés par sa
belle et par les personnages de Musset.
 Nous étions quelques jeunes gens qui nous connaissions
vaguement, de ces copains qui se disent bonjour sur le tram [sic] et parlent
avec ennui du dernier film ou du dernier match de football ; nous vivions
l’un à côté de l’autre sans nous comprendre, et déjà s’ouvrait devant nous la
perspective d’une vie morne et repliée, vie bourgeoise. Un jour, l’un d’entre
nous lança l’idée d’aller faire un camp dans les Ardennes durant les grandes
vacances. Idée venue
d’où ? Je ne sais. Peut-être fut-elle suscitée par l’obscur pressentiment
qu’il y avait quelque chose de bien à accomplir ensemble. Nous
acquiesçâmes avec un enthousiasme mitigé. Ce camp fut néanmoins minutieusement
préparé, et nous partîmes au milieu de juillet pour une durée d’environ une
semaine. Alors eut lieu le miracle. Loin de la
ville, loin de nos petites habitudes quotidiennes, loin des toujours identiques
et mornes horizons, nous nous découvrîmes une autre âme, ou plutôt nous nous
sentîmes en permanence, au contact de la nature, cet état de conscience qui est
le nôtre certains soirs où nous sommes seuls avec nous-mêmes et où nous nous
sentons purs et éloignés du monde ; mais ce sentiment, nous l’avions en
commun. Nous
sympathisions naturellement : La pluie
familière et chantante qui comme une caresse glisse le long du visage et
apporte au corps une fraîcheur attendue, la rivière au tracé capricieux que
l’on sent couler sans la voir, à travers un rideau d’arbres, et dont l’eau sera
douce aux pieds fatigués, la forêt tranquille où l’on peut marcher des heures
sans rencontrer personne qu’un paysan méditatif qui chemine solitaire, l’aube
indécise et frileuse, qu’éveillé, la nuit, l’on attend avec une étrange
impatience, comme si le jour qui vient devait tout apporter, nous trouvaient
pour les contempler d’un même cœur. Nos yeux de
citadins voyaient pour la première fois vraiment la nature et dans notre
ivresse, il nous semblait pressentir la joie émerveillée des aventuriers
d’autrefois découvreurs de terres[4]. Nous étions quelques jeunes gens qui nous connaissions
vaguement, de ces copains qui se disent bonjour sur le tram [sic] et parlent
avec ennui du dernier film ou du dernier match de football ; nous vivions
l’un à côté de l’autre sans nous comprendre, et déjà s’ouvrait devant nous la
perspective d’une vie morne et repliée, vie bourgeoise. Un jour, l’un d’entre
nous lança l’idée d’aller faire un camp dans les Ardennes durant les grandes
vacances. Idée venue
d’où ? Je ne sais. Peut-être fut-elle suscitée par l’obscur pressentiment
qu’il y avait quelque chose de bien à accomplir ensemble. Nous
acquiesçâmes avec un enthousiasme mitigé. Ce camp fut néanmoins minutieusement
préparé, et nous partîmes au milieu de juillet pour une durée d’environ une
semaine. Alors eut lieu le miracle. Loin de la
ville, loin de nos petites habitudes quotidiennes, loin des toujours identiques
et mornes horizons, nous nous découvrîmes une autre âme, ou plutôt nous nous
sentîmes en permanence, au contact de la nature, cet état de conscience qui est
le nôtre certains soirs où nous sommes seuls avec nous-mêmes et où nous nous
sentons purs et éloignés du monde ; mais ce sentiment, nous l’avions en
commun. Nous
sympathisions naturellement : La pluie
familière et chantante qui comme une caresse glisse le long du visage et
apporte au corps une fraîcheur attendue, la rivière au tracé capricieux que
l’on sent couler sans la voir, à travers un rideau d’arbres, et dont l’eau sera
douce aux pieds fatigués, la forêt tranquille où l’on peut marcher des heures
sans rencontrer personne qu’un paysan méditatif qui chemine solitaire, l’aube
indécise et frileuse, qu’éveillé, la nuit, l’on attend avec une étrange
impatience, comme si le jour qui vient devait tout apporter, nous trouvaient
pour les contempler d’un même cœur. Nos yeux de
citadins voyaient pour la première fois vraiment la nature et dans notre
ivresse, il nous semblait pressentir la joie émerveillée des aventuriers
d’autrefois découvreurs de terres[4]. Lors de cette randonnée de plusieurs jours, mon père se lève chaque
matin, heureux avec au cœur l’impression de partir à l’aventure d’une
journée. Il se découvre nomade. L’âme en fête,
il est ravi de fixer sur la pellicule de
son appareil photo quelques clichés de cette belle l’aventure qu’il pourra
commenter à Suzanne à son retour de vacances familiales.
Dans la lumière du soir à l’approche d’un sous-bois, aux
premières notes du chant du merle, Raymond s’amuse à comparer les notes
sifflées à la mélodie de Beethoven, Danse villageoise. Lors des feux de fin de journée ils évoquent leurs distractions
préférées, leurs découvertes et leurs lectures. S’allongeant dans l’herbe fraîche,
observant le firmament et ses voies étoilées de l’été, l’un deux cite
Antoine de Saint-Exupéry écrivant dans Citadelle, que l’on cherche sa
vérité dans les étoiles. Chacun médite l’idée dans le silence de la nuit et
Raymond décrit alors les récits de l’auteur de Vol de nuit, passionné
d’aventures. Ces jeunes en mal d’héroïsme se promettent d’acquérir l’ouvrage en
question, rêvent sous la lune et décident d’un commun accord de solliciter la
Force Aérienne pour effectuer leur service militaire. Livrés à eux-mêmes, sans la présence du moindre adulte, à la
différence de l’année dernière, les yeux remplis de paysages et l’âme
débordante de conversations partagées évoquant la musique ou la littérature,
les jeunes gens décident de ne plus se quitter. Grandis par l’expérience vécue
sans tension, nourris des échanges chaleureux autour du feu du soir, ils sont
heureux de se sentir enfin moins seuls sur le chemin de leur vie. Aujourd’hui,
les voilà déterminés à participer ensemble à de nombreuses activités communes :
aller au cinéma, écrire des articles et, pourquoi pas, éditer un journal dans
le quartier. Tous y pensent avec enthousiasme et promettent d’en reparler.
Traversant villages et hameaux, mon père respire à pleins poumons cette liberté
recherchée, réfléchissant déjà à une nouvelle histoire à écrire, à raconter.
À suivre…
| | | |
| |  | |
|
|
|
| | | |

Chaque mois, la Fondation Brel vous propose un extrait d’un des nombreux témoignages du film "J’arrive".Charles Nemry, chirurgien belge. Contexte : Il opère Jacques Brel à Bruxelles le 16 novembre 1974.
| | | |
|
|
|
| | Offre pour la Saint-Valentin | | | |
| | Du samedi 12 au dimanche 20 février, un second parcours offert à l’achat d’un ticket pour la promenade « Avec Brel à Bruxelles ». | | | |
| | Pendant ce mois de janvier, les oeuvres de Jacques Brel ont inspiré… | | | |
| | Ne me quitte pas
Dans une nouvelle série télévisée intitulée « Moonhaven ». Synopsis : Ce thriller à suspense est centré sur Bella Sway, pilote de cargo lunaire et contrebandière 100 ans dans le futur, qui se retrouve accusée d'un crime et abandonnée sur Moonhaven, une communauté utopique installée sur un jardin d'Eden de 500 miles carrés construit sur la lune pour trouver des solutions aux problèmes qui mettront bientôt fin à la civilisation de notre mère la Terre. Sceptique au Paradis, Bella est entraînée dans une conspiration visant à prendre le contrôle de l'intelligence artificielle responsable des miracles de Moonhaven et fait équipe avec un détective local, Paul Serno, pour arrêter les forces qui veulent détruire le dernier espoir de la Terre avant d'être elles-mêmes détruites. Sur la placeL’intégralité du texte de la chanson dans le livre « Marie Madeleine, un destin français » de Jean-Claude Canquery, à paraitre chez L’Harmattan. Le MoribondDans son adaptation anglaise « Seasons in the Sun » reprise dans la série Netflix « The Midnight Club ». On n’oublie rienSynchronisation de la chanson « On n’oublie rien » interprétée par Juliette Gréco dans la bande-annonce du long-métrage « Mrs. Harris Goes to Paris » de Anthony Fabian, avec Lesley Manville, Isabelle Huppert, Alba Baptista, Lucas Bravo, Rose Williams, Lambert Wilson et Jason Isaacs. En salle en juin 2022. Ne me quitte pasDans une transcription pour chorale par Koor&Stem. J’aimais, Mathilde, La Fanette, Les désespérés, Qu’avons-nous fait, Les timides, Ne me quitte pas, Fils de…, La valse à mille temps, Madeleine, Quand on n’a que l’amourDans une traduction finnoise par Timo Tuominen. | | | |
|
|
|
| | Vos témoignages« Très chouette visite et musée musical très joliment chantant ! »
Eléonore, le 29 décembre (exposition) « Quel plaisir ce moment passé seul dans la Fondation Jacques Brel. Certains diront qu’il s’agit surtout de documents vidéos et numériques. Mais tout cela est d’une grande richesse et l’émotion est bien là ! Seul dans la Fondation ? Non ! Avec Jef, Mathilde, Madeleine et Jacques. »
Maurice, le 7 janvier (exposition) « Très beau film. Émouvant. Bel hommage aussi à ceux qui l’ont aimé sincèrement, sa femme, Jojo et ses filles ! »
Le 2 janvier (film « J’arrive ») | | | |
|
|
|
| | | | © Fondation Jacques Brel d’utilité publique 2018. | | | |
|
|
|
|